Odile de Vasselot de Régné
En 1940, âgée d’à peine vingt ans, Odile de Vasselot de Régné commet son premier acte de résistance. D’autres suivront au sein des réseaux de renseignement et d’évasion Zéro France et Comète. La Médaillée de la Résistance n’a depuis jamais cessé de témoigner.

Vous êtes née en 1922, soit 4 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Quelle a été votre enfance ?
C’est une période dont je garde un merveilleux souvenir. Mes parents étaient très amoureux. Papa était officier. Je suis née à Saumur lorsqu’il était instructeur de cavalerie. J’ai ensuite passé mes premières années d’existence dans différentes garnisons, à Dijon notamment. En réalité, nous suivions mon grand-oncle, le frère de ma grand-mère, le général de Vaulgrenant, qui y était "gouverneur". Ce dernier est ensuite parti à Metz, la sixième région. Papa était son officier d’ordonnance. Nous avons donc vécu à Metz au palais du gouverneur. […] Nous étions quatre enfants. Mon frère allait chez les Jésuites et mes sœurs et moi allions au Sacré-Cœur de Metz où nous avons été très heureuses. Lorsque mon oncle, le général de Vaulgrenant, a pris sa retraite à 62 ans, papa est resté à Metz, au 30e dragons. J’ai passé mon baccalauréat en 1939. Nous passions l’écrit à Metz et l’oral à Strasbourg. Ma sœur et moi avons été reçues ; nous avions passé le baccalauréat ensemble. Nous sommes ensuite parties en vacances en juillet 1939. La guerre s’est déclarée pendant celles-ci.
Quel est votre premier souvenir lié à la Résistance ?
Dès le début de la guerre, mes sœurs et moi avons commencé à déchirer des affiches, qu’elles soient de Vichy ou allemandes. Parfois, il y en avait de Philippe Henriot. Il parlait tous les soirs à la TSF pour dire aux jeunes hommes de s’engager, même sous uniforme allemand. On faisait alors une bulle qui sortait de sa bouche avec notre craie et on écrivait : "Je suis un salaud." Nous dessinions aussi des croix de Lorraine avec une petite craie sur les murs des hôtels où habitaient les Allemands. Très vite, on a reçu des journaux clandestins dans notre boîte aux lettres. Je me suis alors dit que ce que nous faisions n’était que des broutilles et qu’il devait exister des choses plus sérieuses. Je me suis mise à chercher, sans pouvoir en parler par peur d’être dénoncée.
Quel rôle le réseau Zéro France vous avait-il attribué ?
Tous les week-ends, je devais partir pour Toulouse avec un paquet. J’ai su après-guerre que c’était le "courrier descendant". Je prenais le train de nuit le vendredi soir à 20h. Le samedi midi, arrivée à Toulouse, je me rendais dans un restaurant. Je demandais la serveuse Rolande. Je posais le paquet sur la chaise à côté de moi. Elle m’apportait un autre paquet, le "courrier remontant". Je le mettais dans ma valise, bien caché. Je reprenais le train le samedi soir et rentrais le dimanche matin à Paris. J’avais ensuite rendez-vous avec le réseau en face de l’église Saint-Philippe-du-Roule. Le plus difficile était de mentir à maman au sujet de mes activités, d’autant plus que je devais découcher deux nuits par semaine. J’avais fait l’école des bibliothécaires à l’Institut catholique. Je lui avais donc dit qu’on me demandait d’aller à Versailles pour fonder une bibliothèque pour l’hôpital de la ville alors que je ne savais même pas s’il y en avait un.
Une fois le réseau Comète intégré, vous avez ensuite aidé de nombreux aviateurs à franchir la frontière franco-belge. Pouvez-vous nous raconter votre premier passage ?
C’était un trajet Bachy-Rumes. Maurice Bricout, Jean-Jacques et moi-même sommes partis par la porte du fond de la maison Bricout, c’est-à-dire celle qui donnait sur les cages à lapins et le petit potager. Nous nous sommes retrouvés dans la plaine. La nuit était noire. Seul un phare tournait au loin. Maurice était devant. Il s’est tourné vers moi : "Vous voyez les petites lumières là-bas. C’est le poste de douane allemand. Surtout pas un bruit !" Je n’avais pas envie de parler. Nous avons continué à marcher […] jusqu’aux fils barbelés, qui comprenaient deux rangées, au milieu desquels il y avait de l’eau. Je me suis accroupie et Maurice m’a aidée à passer la première rangée. Il m’a ensuite dit : "Maintenant, il faut marcher dans l’eau pour que les chiens perdent notre trace." Heureusement, j’avais des bottes. Nous avons marché cent mètres dans l’eau et nous sommes ressortis plus loin. Nous avons encore marché deux kilomètres environ, jusqu’à voir les toits d’un village. Ils étaient encore plus noirs que le ciel. Maurice nous a plantés devant une porte de maison. "Vous restez là. Je vais faire le tour et aller dans la pièce où je sais qu’ils se tiennent. Si on vient vous ouvrir, c’est bon. Dans le cas contraire, il faudrait repartir. Cela voudra dire que ça sent mauvais." Jean-Jacques et moi avons attendu. Maurice est venu nous ouvrir. Nous avons pénétré dans cette maison noire comme un four et ouvert une porte. La pièce était éclairée a giorno. Il y avait plein de monde dedans. […] Nous avons fini par repérer deux types qui étaient les passeurs. Ils rassemblaient à des étudiants. Quatre autres étaient les aviateurs alliés, les boys, que nous venions chercher. […] Ils ont fait leurs adieux à leurs anciens guides et ont embrassé toutes les filles de l’assistance. Ils donnaient de grandes claques dans le dos et disaient "On se reverra après la guerre." À chaque fois, nous nous mettions ensuite en route et nous refaisions le même trajet avec les aviateurs, y compris le ruisseau. Ils enlevaient leurs souliers et leurs chaussettes. Nous arrivions de nouveau chez les Bricout. Rachel Bricout avait préparé un petit frichti parce qu’il était très tard. […] Nous allions ensuite nous coucher. Le réveil était très tôt. Six heures, parfois cinq heures du matin. Nous prenions un rapide petit-déjeuner debout dans la cuisine. De Bachy, il fallait ensuite rejoindre la gare de Baisieux où nous prenions un petit train, réservé aux cheminots, qui nous amenait à Lille pour prendre l’express de Paris à huit heures du matin.
Quel est votre souvenir le plus marquant au sein du réseau Comète ?
Le jour où nous avons été trahis. C’était le 4 janvier 1944. J’effectuais le trajet Bachy-Rumes, sans doute celui que j’ai le plus souvent fait. À Rumes, au lieu de trouver quatre boys je n’en ai trouvé que deux. J’ai dit au bistrotier que je partais avec eux et que je reviendrai le lendemain chercher les deux autres. À Lille, nous avons pris le train à destination de Paris. Entre Douai et Arras, j’ai entendu sur ma droite : "Présentez vos cartes d’identité s’il vous plaît !" Mon sang n’a fait qu’un tour. J’ai présenté ma carte la première. La Gestapo me l’a rendue sans même la regarder. Un agent a gardé la carte du boy qui était à ma droite et lui a dit : "Comment vous appelez-vous ?" [Elle reproduit le geste qu’a fait le boy signifiant qu’il n’a pas compris la question]. Le type a demandé sa carte d’identité au boy qui était à ma gauche et lui a posé la même question. Lui non plus ne l’a pas comprise et n’a donc pas répondu. Les Allemands savaient que les boys seraient dans ce train. Ils les ont fait descendre à Arras. Les boys sont passés devant moi, ne m’ont pas fait de clin d’œil mais m’ont regardée. J’imagine qu’ils voulaient me dire merci quand même, bonne chance ou bon courage. Ils ont seulement été prisonniers de guerre et sont revenus. Ce qui m’étonne encore, c’est que les Allemands ne savaient pas que le convoyeur était une jeune fille. Comme j’étais parfaitement à leur convenance, à savoir yeux bleus, blonde et jeune, ils ne m’ont rien demandé.
Pourquoi est-il important pour vous de continuer à témoigner ?
Il n’y a plus beaucoup de personnes ayant vécu la guerre et étant encore en vie. Je dis toujours que je ne suis pas venue pour raconter des histoires d’anciens combattants, aussi passionnant que ce soit. Je veux que les personnes qui m’écoutent ne retiennent qu’une seule chose : il ne faut jamais baisser les bras malgré les difficultés que l’on a eues et auxquelles on aura encore à faire face. Il y a toujours une solution.
Artikeln der Zeitschrift
-
Der Datensatz
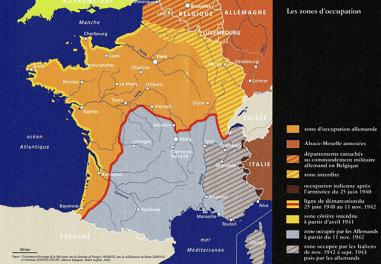
1941 - Résister, s’organiser
Si les événements de l’année 1941 sont souvent passés sous silence, ils n’en restent pas moins décisifs, tant sur le sol français qu’à l’extérieur de celui-ci. En effet, c’est bien dès 1941 que les premiers mouvements de résistance civile et militaire se structurent et font, dans le même temps, la l...Weiter lesen -
Das Ereignis

2021, commémorer les premières résistances
Weiter lesen -
Der Akteur
L’association des engagés volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon
À l’occasion du 80e anniversaire du ralliement de Saint-Pierre-et-Miquelon à la France Libre, l’association locale des engagés volontaires souhaite inscrire dans le marbre les noms de celles et ceux qui, refusant la soumission à Vichy, se sont mobilisés de 1940 au 1er août 1943. ...Weiter lesen

