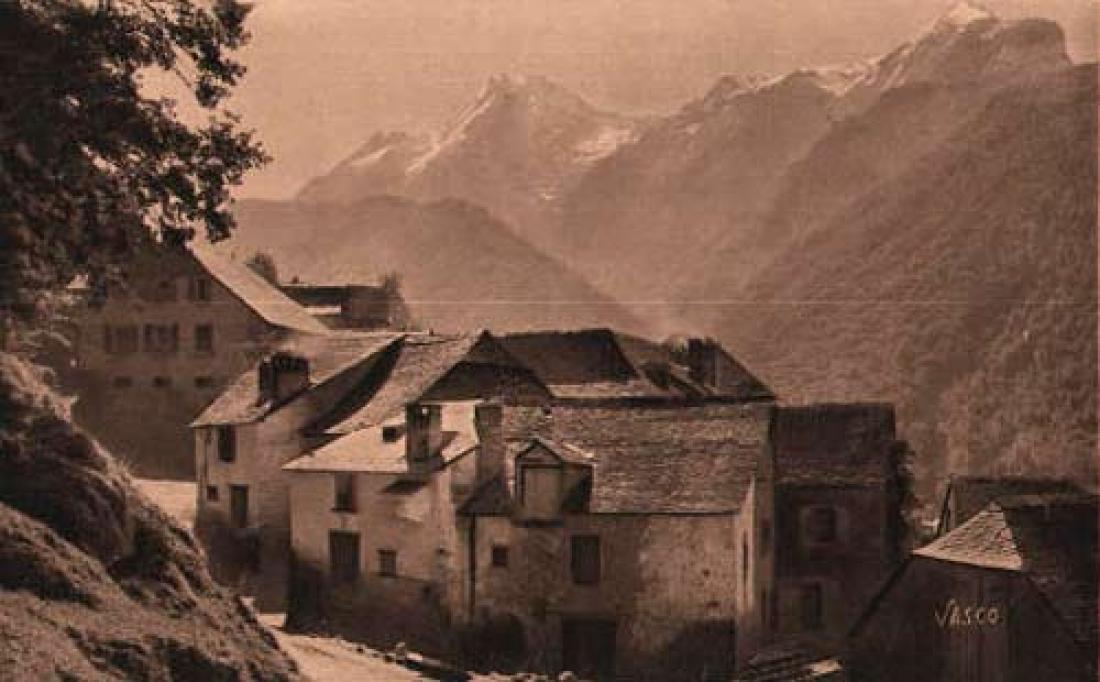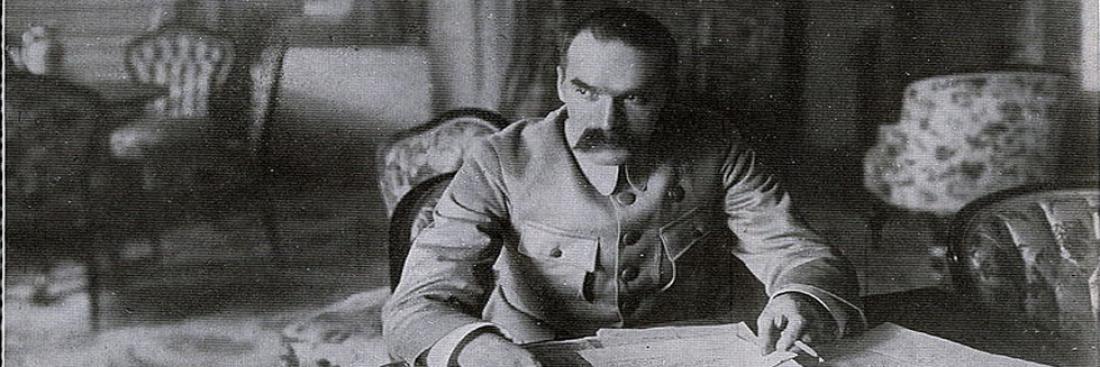Des décorations, en reconnaissance de la nation

En instituant la Croix de guerre 1914-1918, le décret d'avril 1915 instaure le principe d'honorer les actes de bravoure individuels et les actions d'éclat des formations militaires. Cependant, cette conception perdure bien au delà de la Grande Guerre.
D'autres décorations récompensent la bravoure et l'abnégation de ceux qui se sont particulièrement distingués lors d'engagements armés.