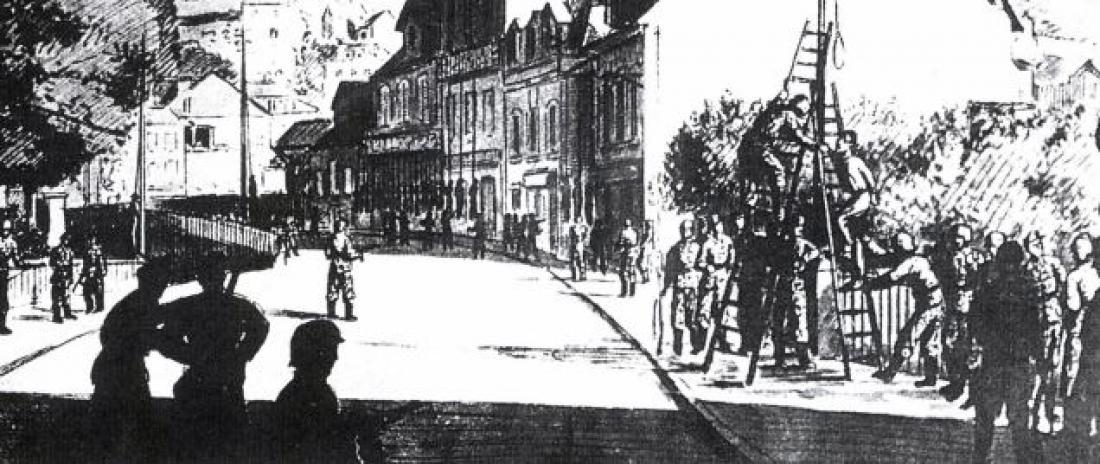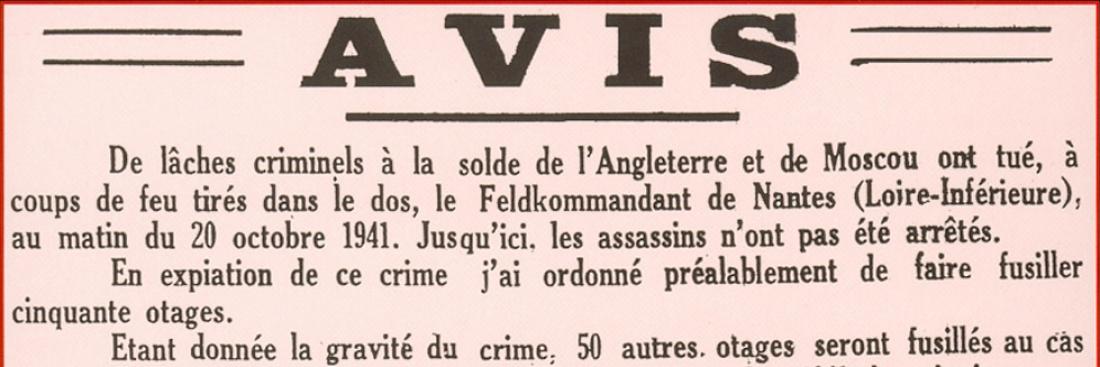Le 10 juin 1944, la population du bourg limousin d’Oradour-sur-Glane est massacrée par une troupe d’environ deux cents Waffen SS. Hommes, femmes et enfants sont passés par les armes et le feu ; le village est incendié et réduit en quelques heures à un champ de ruines. Conservé en l’état et classé monument historique, ce site témoigne des atrocités nazies et de la nécessité du souvenir, en hommage aux 643 victimes de ce crime abject.
Depuis 1999, le Centre de la mémoire d’Oradour, nouvel et unique accès aux ruines du village martyr, propose aux visiteurs du site une exposition permanente. Celle-ci, constituée de documents écrits ou audiovisuels, permet de replacer dans son contexte le drame d’Oradour, de présenter le village d’Oradour avant et pendant la guerre, d’expliquer le déroulement du massacre, d’informer le visiteur et de le faire réfléchir sur les questions de la justice et de la mémoire. Des expositions temporaires complètent ce parcours : elles permettent de varier les approches et de faire le lien avec l’histoire et la mémoire d’autres conflits contemporains, d’autres violences faites aux civils.
Une galerie composée des visages des victimes, imprimés sur des plaques de porcelaine, accompagne le visiteur dans le couloir menant aux ruines. Elle lui permet de découvrir que derrière le nombre très important de victimes, 643, il y a autant de visages, de personnes, de vies, de destins.
Espace de citoyenneté au message universel, le centre développe de nombreuses actions pédagogiques, scientifiques et culturelles. Une programmation saisonnière de conférences, représentations théâtrales ou musicales inscrit le Centre de la mémoire d’Oradour parmi les acteurs culturels locaux et nationaux.
Doté d’un centre de documentation très riche en publications et conservant également des archives privées, le Centre de la mémoire est un outil pédagogique. Il dispose de salles d’accueil pour les scolaires et d’un service éducatif leur proposant de nombreuses activités.
Le Centre de la mémoire est le lien nécessaire entre l’histoire d’Oradour, les victimes du drame du 10 juin 1944, leurs familles et les citoyens de demain.