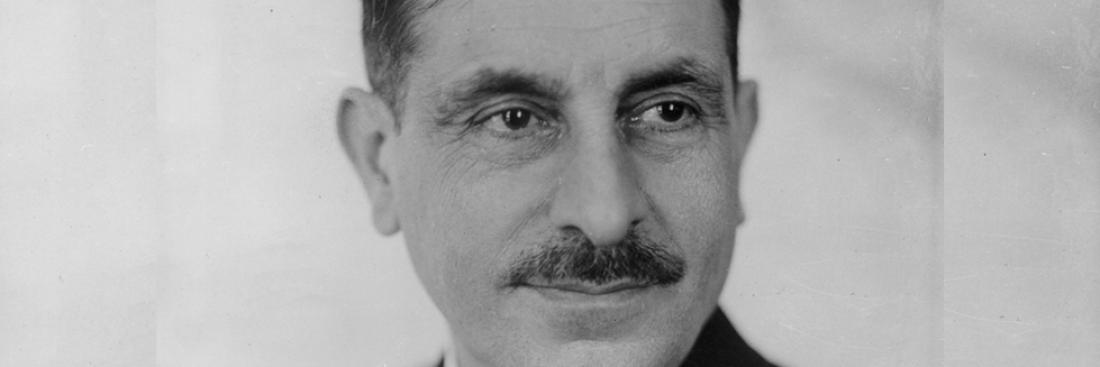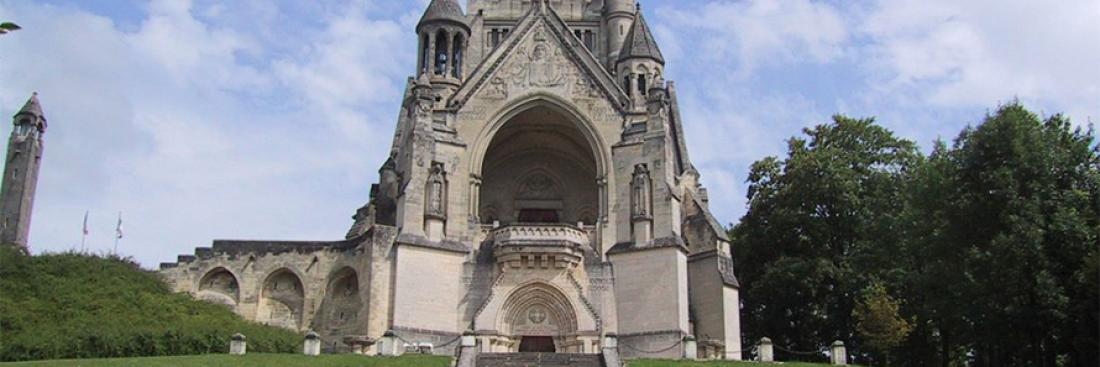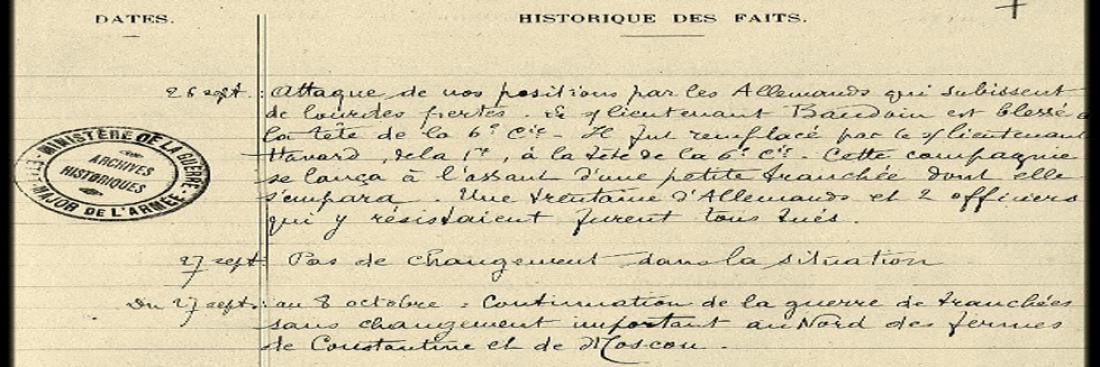Des peintres au service de la Marine

D'abord assimilée à la peinture d'histoire et à celle de paysage, la peinture à sujet maritime devient progressivement un genre à part entière parallèlement avec la reconnaissance officielle parmi les peintres de marine, ou marinistes, d'artistes au service de la Marine, d'où leur nom de « peintres de la Marine » .