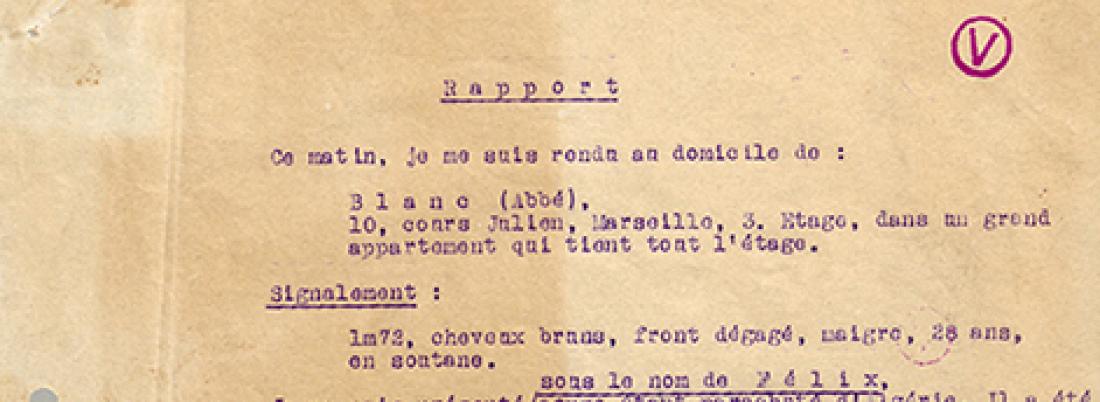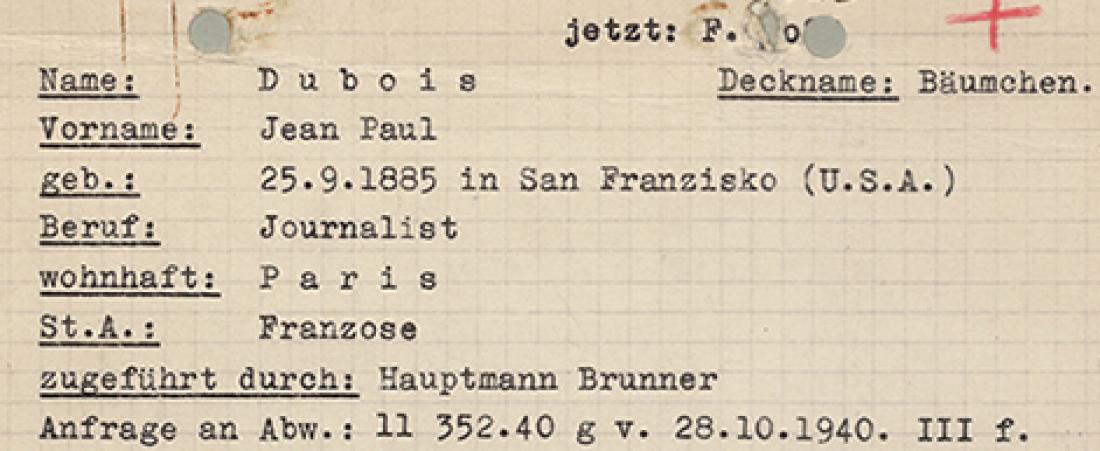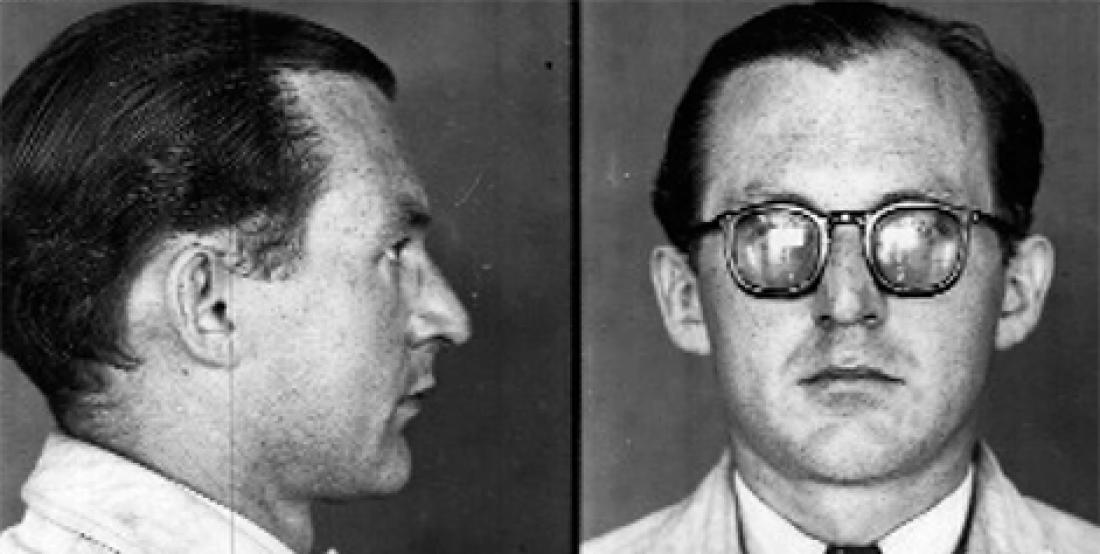1939

En 1938, la guerre paraît imminente quand l'Allemagne annexe l'Autriche et revendique une partie de la Tchécoslovaquie. La signature, par le Président du Conseil français Édouard Daladier et le Premier ministre britannique Neville Chamberlain, des accords de Munich qui donnent satisfaction à Hitler, en recule l'échéance. La crainte ressurgit lorsque les troupes allemandes entrent à Prague le 15 mars 1939 et que le Führer manifeste des visées expansionnistes sur la Pologne.