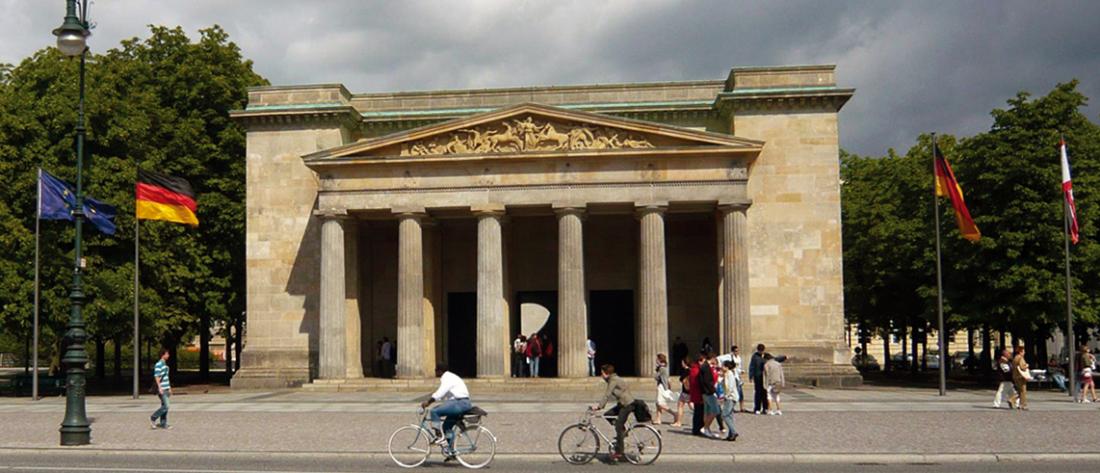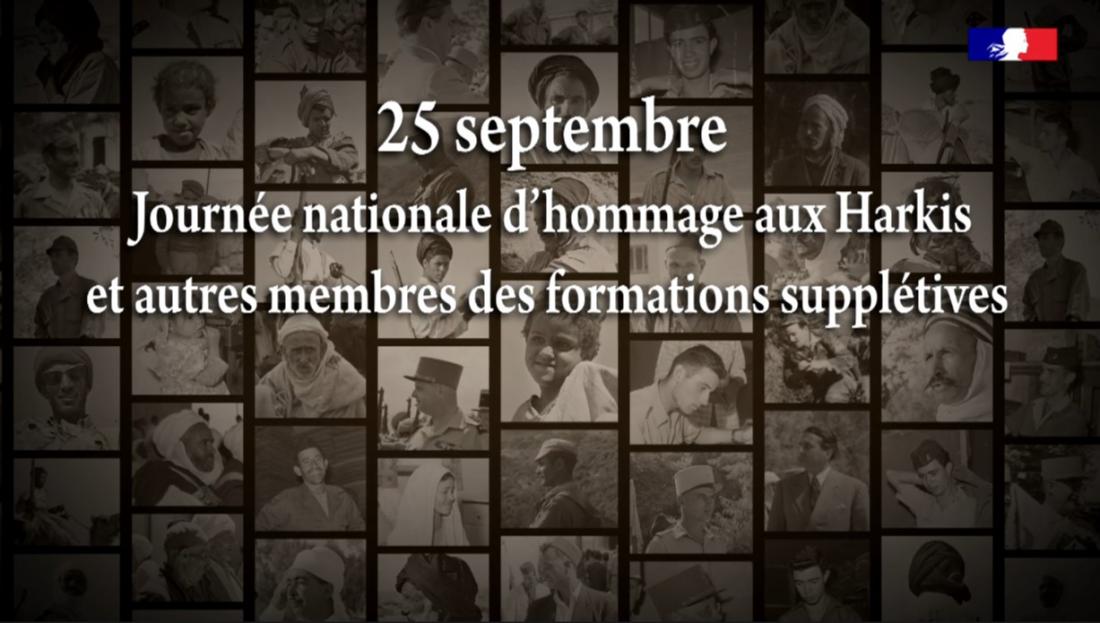Dans le cadre du développement des approches numériques innovantes à destination des acteurs et des usagers de l’enseignement de défense, la Direction des patrimoines, de la mémoire et des archives (DPMA) a conçu et réalisé par type de porteurs de projets (établissements scolaires, établissements scolaires français en France et à l’étranger, classes de défense, trinômes académiques, attachés de défense) des mallettes numériques de soutien à l’enseignement de défense, pour regrouper sur un même format toutes les informations utiles concernant les soutiens à l’enseignement de défense proposés par le ministère des armées.
Cet outil numérique s’inscrit dans le cadre de la simplification de l’action publique. Il permettra aux porteurs de projets et, plus largement, à l’ensemble des partenaires de l’enseignement de défense (associations, collectivités territoriales etc.), d’identifier aisément les ressources proposées par le ministère des armées et la procédure à suivre pour en bénéficier.
Veuillez trouver ci-dessous l’ensemble des mallettes proposées par la DPMA :
Mallette Établissements scolaires
Télécharger la version liens hypertextes pour emploi en numérique
Consulter la rubrique consacrée au financement de projets pédagogiques
Mallette Établissements scolaires français en France et à l’étranger
Télécharger la version liens hypertextes pour emploi en numérique
Consulter la rubrique consacrée au financement de projets pédagogiques
Mallette Classes de défense
Télécharger la version liens hypertextes pour emploi en numérique
Retrouver les classes défense dans les académies
Mallette Trinômes académiques
Télécharger la version liens hypertextes pour emploi en numérique
Consulter la rubrique dédiée aux trinômes académiques
Mallette Attachés de défense
Télécharger la version liens hypertextes pour emploi en numérique