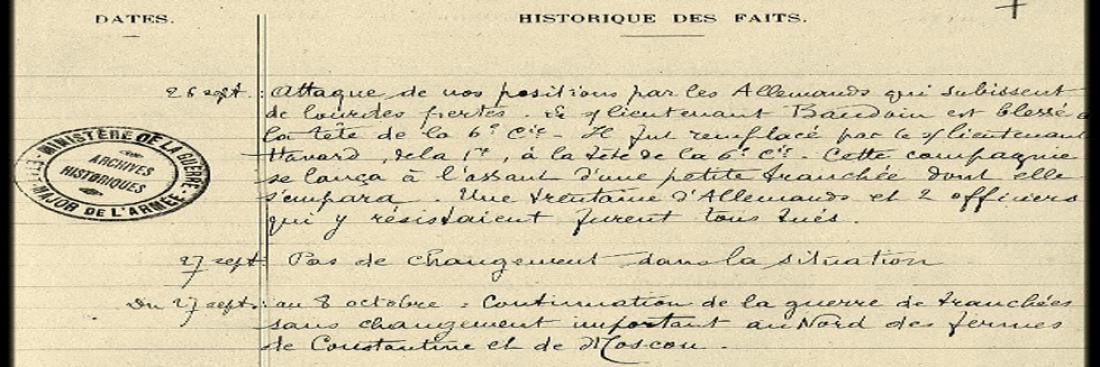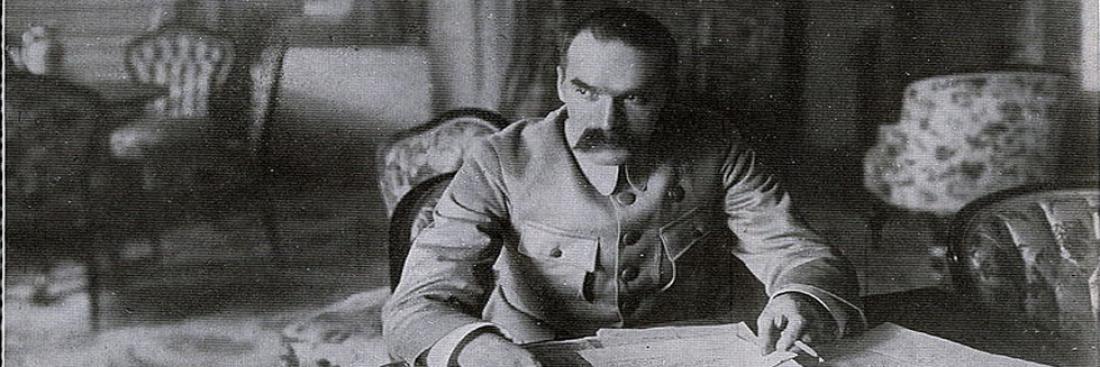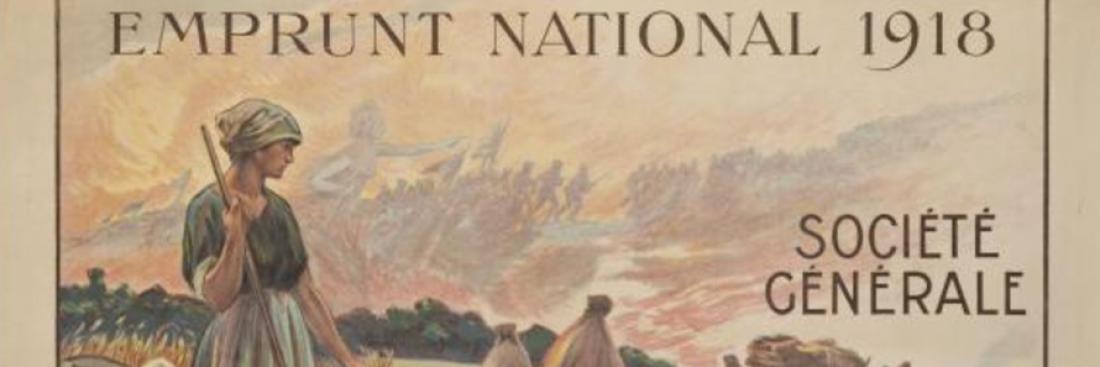1940 - 1946. L'internement des tsiganes en France

Selon l'historien Denis PESCHANSKI, environ 3 000 Tsiganes - vivant pour la plupart en France - ont été regroupés dans près de 30 camps d'internements entre 1940 et 1946. Si le gouvernement de Vichy et les troupes d'occupation allemande portent la responsabilité des mesures prises à l'encontre de cette population, il faut cependant rappeler que celles-ci ont trouvé leurs justifications dans les lois votées dés le début du XXème siècle par les responsables politiques de la IIIème République.