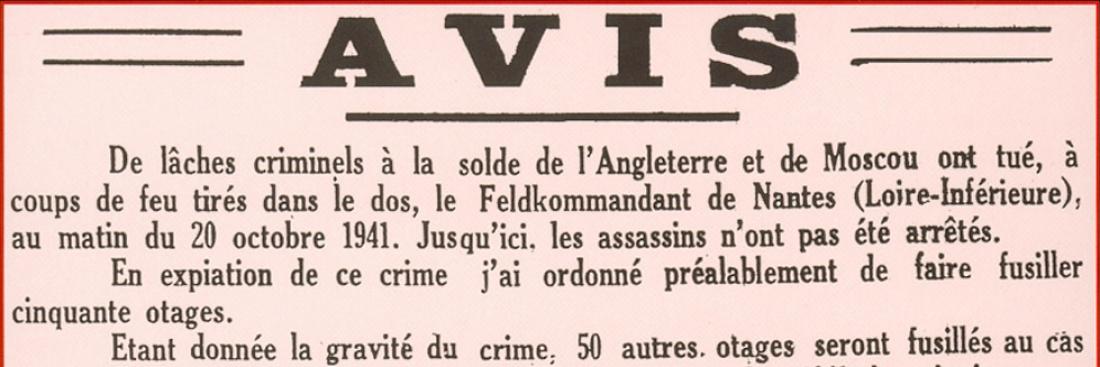Défilé des Américains dans les rues d'Oran après le débarquement. © Service historique de la défense
Au printemps 1942, les forces de l'Axe - Allemagne, Italie, Japon - sont vainqueurs sur tous les fronts : en Russie, en Afrique, dans le Pacifique. L'Allemagne occupe une grande partie des territoires européens.
Victorieuse à l'Est, elle l'est également en Afrique où les troupes germano-italiennes du général Rommel reconquièrent la Cyrénaïque et s'apprêtent à entrer en Egypte.
Les débarquements réussis en Afrique du Nord, le 8 novembre 1942, constituent l'un des éléments qui vont retourner la situation militaire en faveur des Alliés à partir de 1942.