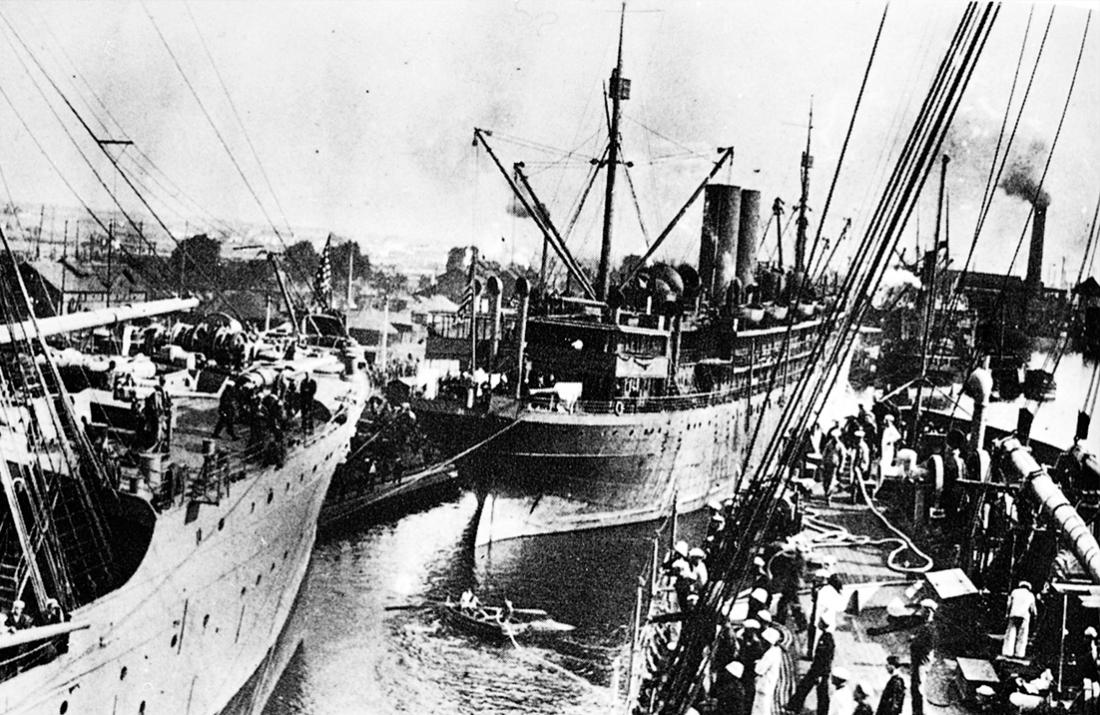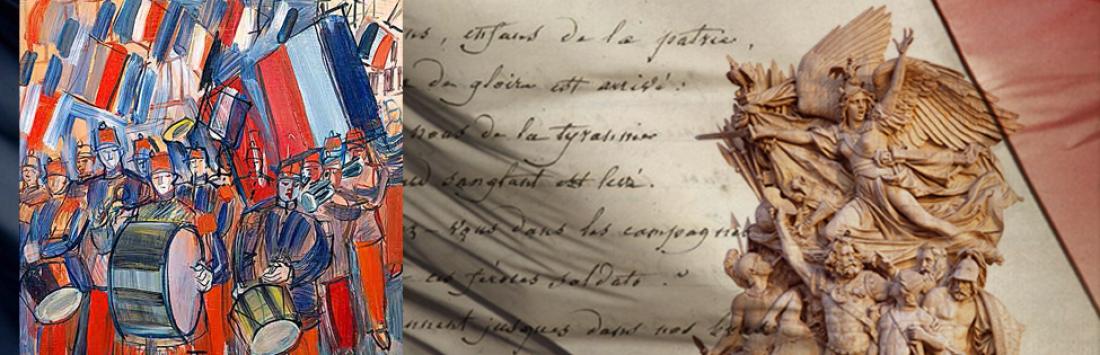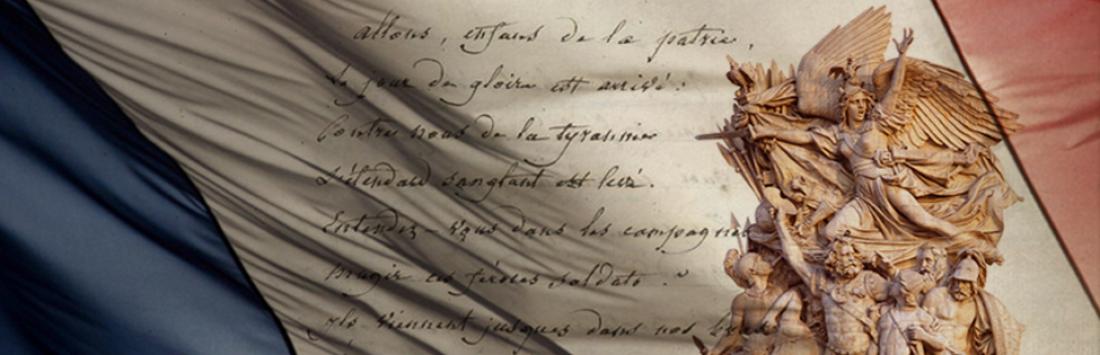Des archives du BCRA au Livre blanc
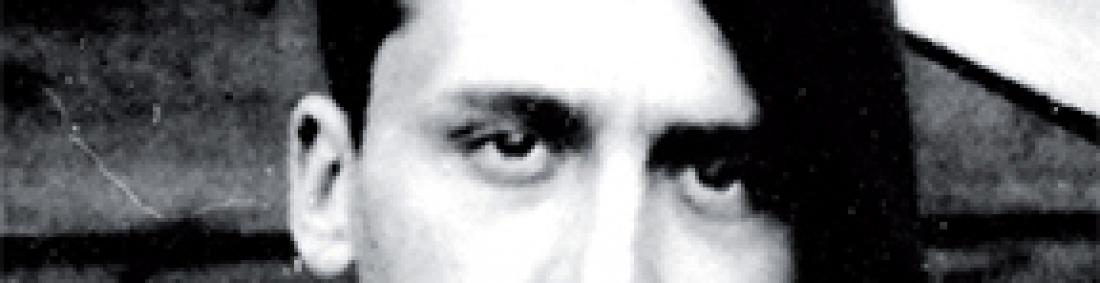
Avant même la libération du territoire national, le besoin d’expliquer et de justifier l’action du BCRA se fait sentir. Fin 1944, cette tâche est confiée à Daniel Cordier, qui s’en acquitte dans des conditions parfois rocambolesques. Aidé par Vitia et Stéphane Hessel, il réalise bientôt l’importance de son travail : rédiger le Livre blanc du Bureau central de renseignements et d’action.