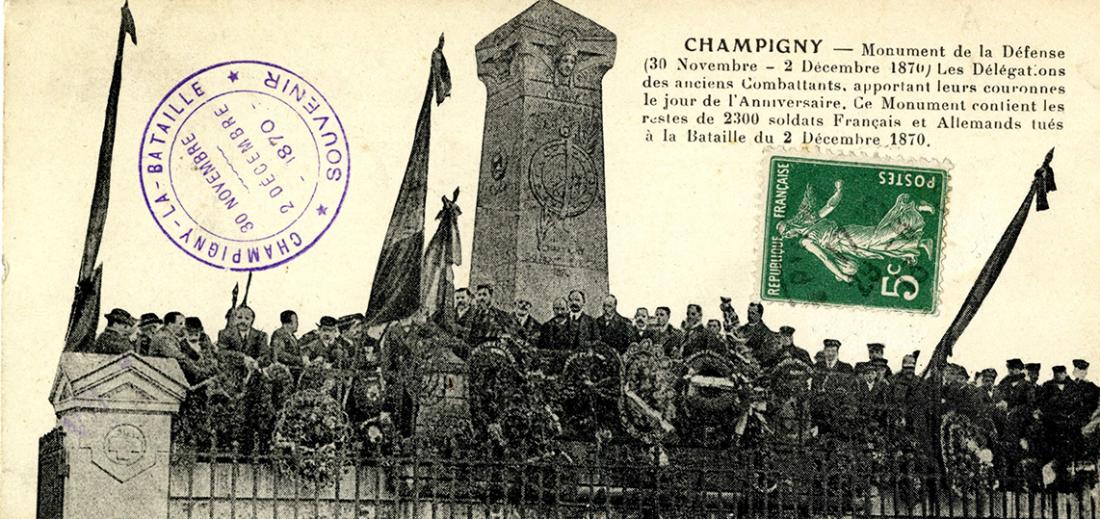Du témoin à l’historien : une histoire de la commémoration

Commémorer, c’est se rappeler un fait, un acte qui fait donc intervenir des témoins. Les commémorations ont toujours reposé, et reposent encore, sur des témoignages d’acteurs et victimes des conflits. L’histoire du témoignage de l’immédiat après-guerre à nos jours dessine une histoire de la commémoration et de la construction de la mémoire.