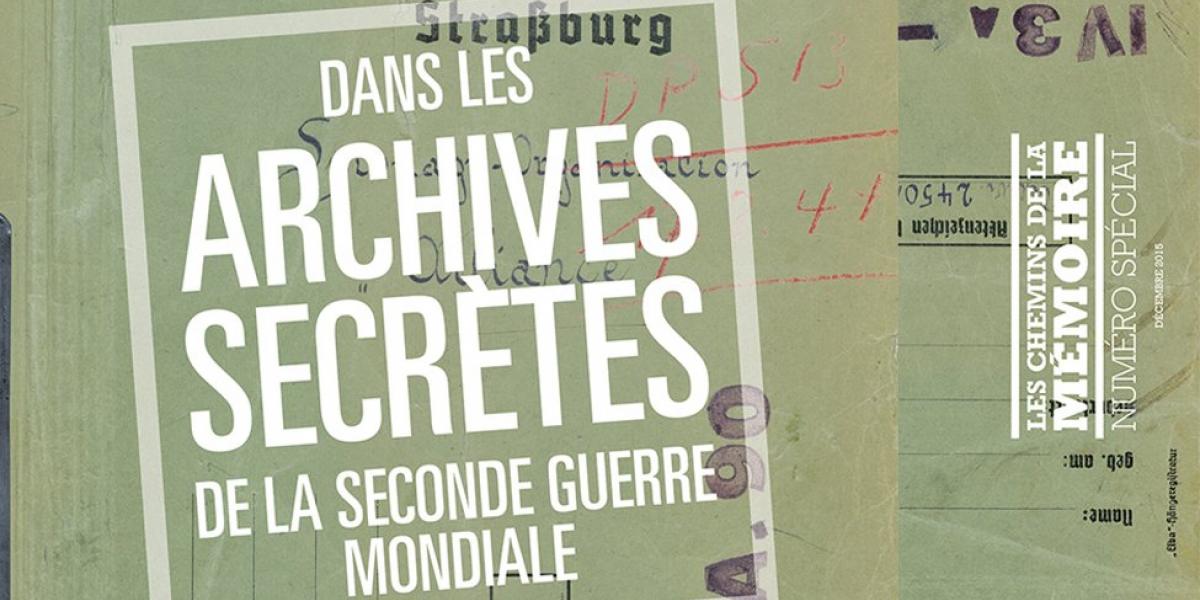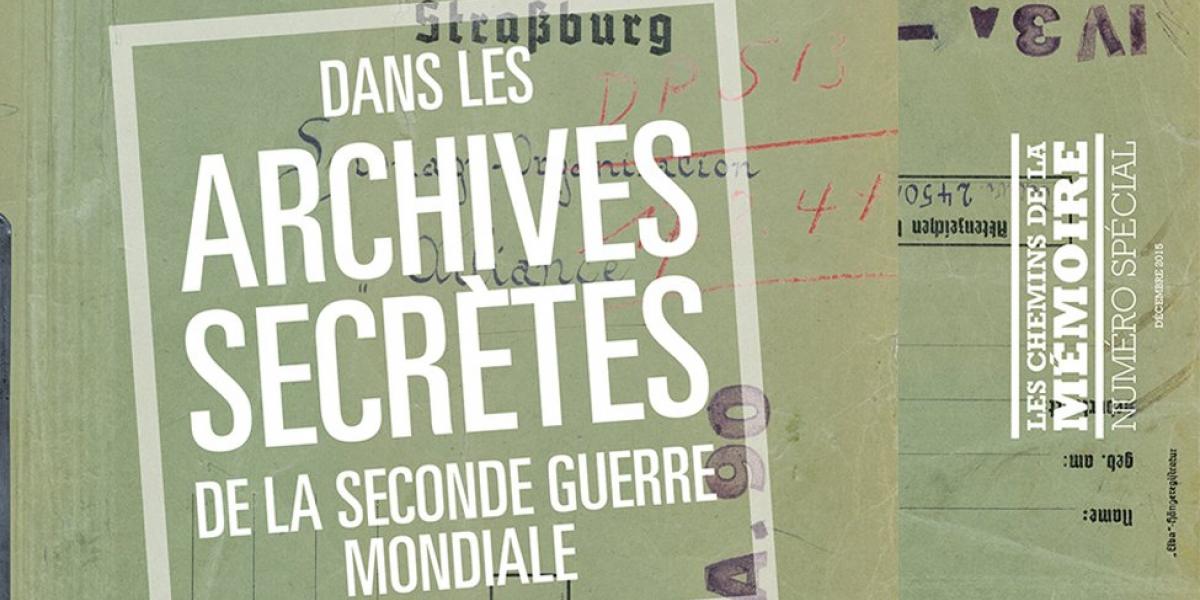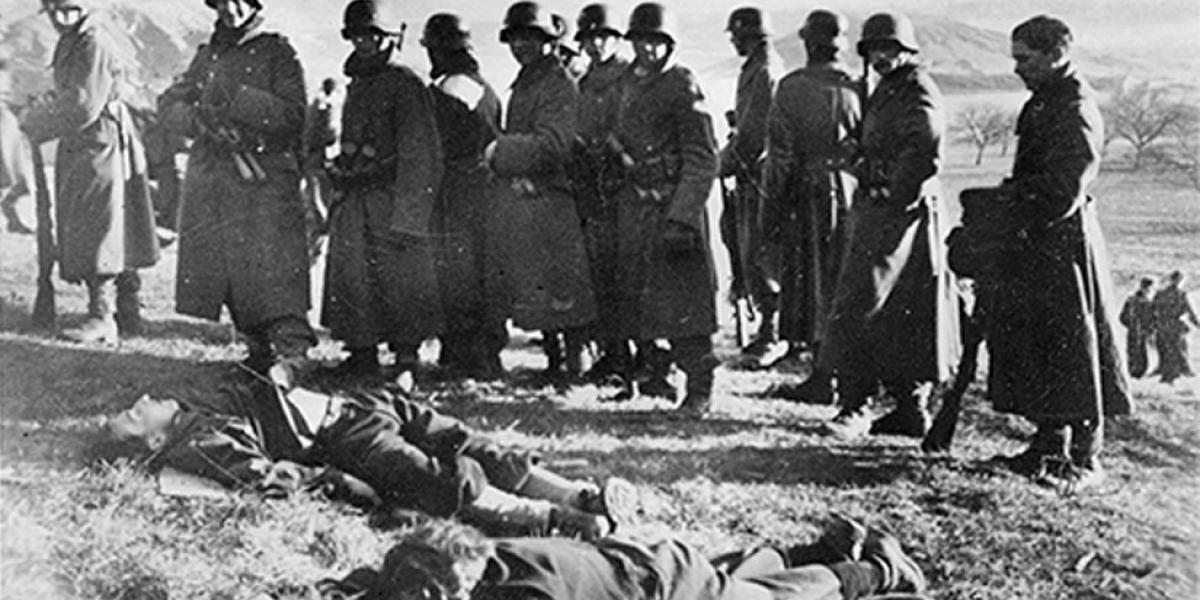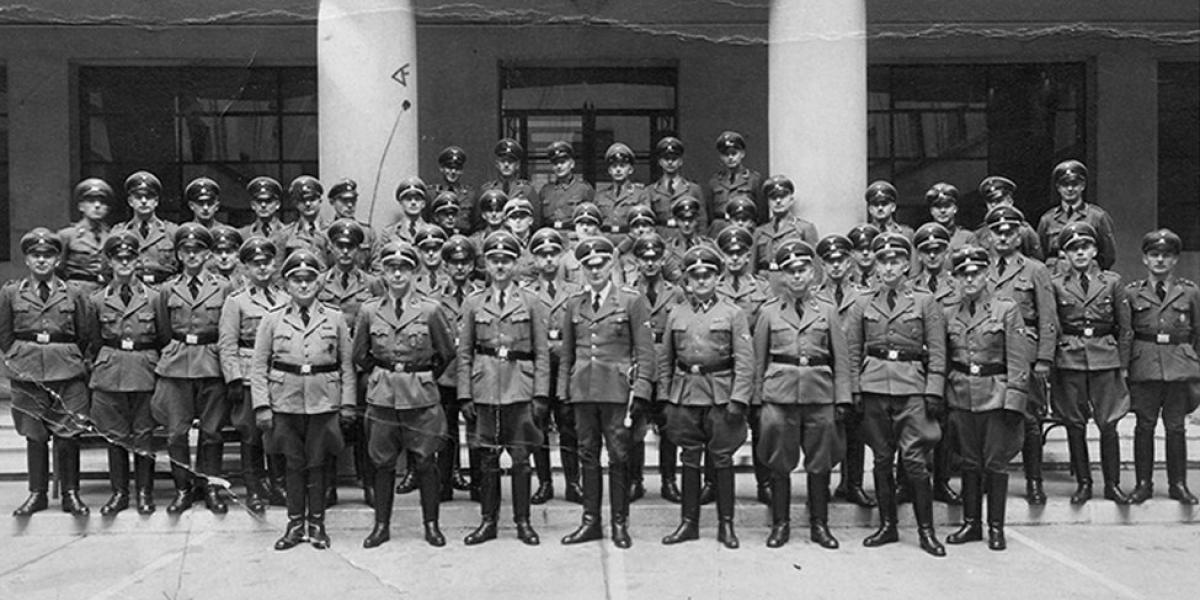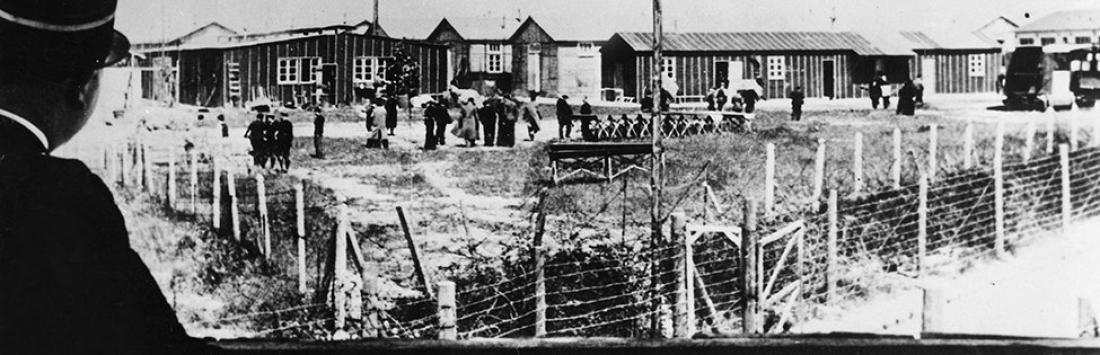D’ABZAC-EPEZY Claude Armée et secrets, 1940-1942, le contre-espionnage de l'armée de Vichy. IRICE - Bulletin de l'Institut Pierre Renouvin 2012-2, n°36, p. 45-56.
ALBERTELLI Sébastien Les Services secrets de la France libre. Le bras armé du général de Gaulle, Nouveau Monde Éditions / Ministère de la Défense, 2012.
ALBERTELLI Sébastien, LEVASSEUR Claire, CREMIEUX-BRILHAC Jean-Louis Atlas de la France libre : de Gaulle et la France libre, une aventure politique, Éditions Autrement, coll. Atlas/Mémoire, 2010.
AUDA Grégory Les Belles années du «milieu», 1940-1944 le grand banditisme dans la machine répressive allemande en France, Éditions Michalon, 2013.
AZÉMA Jean-Pierre Jean Moulin. Le politique, le rebelle, le résistant, Paris, Perrin, 2003.
BERLIÈRE Jean-Marc Policiers français sous l’Occupation, Paris, Perrin, 2001, coll. Tempus, 2009.
BERLIÈRE Jean-Marc & LIAIGRE Franck Liquider les traîtres, Robert Laffont, 2015.
BERLIÈRE Jean-Marc & LE GOARANT DETROMELIN François Liaisons dangereuses : truands, miliciens, résistants… Perrin, 2013.
BONNET Yves Les Services secrets français dans la Seconde Guerre mondiale, Rennes, Ouest-France, 2013.
BRUSTLEIN Gilbert Mémoires d’un terroriste à la retraite, Paris, À compte d’auteur, 1989. De la jeunesse dans la lutte armée, automne 1941, Paris, Fayard, 2004.
CALVI Fabrizio & MASUROVSKY Marc Le Festin du Reich. Le pillage de la France occupée, 1940-1945, Paris, Fayard, 2006.
DE CHEVEIGNÉ Maurice Radio libre, 1940-1945, Paris, Le Félin, 2014.
DAIX Pierre Les Combattants de l’impossible. La tragédie occultée des premiers résistants communistes, Paris, Robert Laffont, 2013.
DELARUE Jacques Histoire de la Gestapo, 1962, Paris, Fayard, 1962, réed. Nouveau Monde Éditions, 2008.
EISMANN Gaël Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée, 1940-1944, Tallandier, 2010.
EISMANN Gaël & MARTENS Stefan (Dir.) Occupation et répression militaire allemande. La politique de «maintien de l'ordre» en Europe occupée, 1939-1945, Autrement, coll. Mémoires n°127, 2006.
FORCADE Olivier La République secrète. Histoire des services spéciaux français de 1918 à 1939, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2008.
FONTAINE Thomas Déportations & génocide : l’impossible oubli, Tallandier, 2009.
GERHARDS Auguste Tribunal de guerre du IIIe Reich. Des centaines de Français fusillés ou déportés. Résistants et héros inconnus - 1939-1945, Paris, Cherche-Midi / Ministère de la Défense, 2014.
GUILLIN François-Yves Le général Delestraint, premier chef de l’Armée secrète, Paris, Plon, 1995.
HENTIC Pierre Agent de l’ombre : Mémoires 1941-1945, Paris, La Martinière, 2012.
HERBERT Ulrich Werner Best. Un nazi de l’ombre, Paris, Tallandier, 2010.
JÄCKEL Eberhard La France dans l’Europe de Hitler, Fayard, 1968.
KITSON Simon Vichy et la chasse aux espions nazis. 1940-1942 : complexités de la politique de collaboration, Paris, Autrement, 2005.
LELEU Jean-Luc, PASSERA Françoise, QUELLIEN Jean & DAEFFLER Michel (Dir.) La France pendant la Seconde Guerre mondiale. Atlas historique, Paris, Fayard / Ministère de la Défense, 2010.
LIAIGRE Franck Les FTP. Nouvelle histoire d’une résistance, Paris, Perrin, 2015.
LOMBARD Maurice «L’Abwehr à Dijon» (1940-1944) in Annales de Bourgogne, 68, 1996, p. 69-78.
MALOUBIER Bob Agent secret de Churchill, Paris, Tallandier, 2011.
MENCHERINI Robert Résistance et Occupation (1940-1944), Midi rouge. Ombres et lumières. Une histoire politique et sociale de Marseille et des Bouches-du-Rhône de 1930 à 1950, tome 3, Paris, Syllepse, 2011.
MEYER Ahlrich L’Occupation allemande en France, 1940-1944, Toulouse, Privat, 2002.
MIANNAY Patrice Dictionnaire des agents doubles dans la Résistance, Paris, Le Cherche Midi, 2005.
NAVARRE Henri (Général) Le Service de renseignements 1871-1944, Plon, 1978.
NEVEU Cédric La Gestapo en Moselle. Une police au coeur de la répression nazie, Metz, Éditions Serpenoise, 2012
PAILLOLE Paul Services spéciaux, Robert Laffont, Paris, 1975.
PEAN Pierre & DUCASTEL Laurent Jean Moulin, L’ultime mystère, Paris, Albin Michel, 2015.
PENNETIER Claude Les Fusillés (1940-1944), Dictionnaire biographique des fusillés et exécutés par condamnation et comme otages et guillotinés en France pendant l’Occupation, Paris, Éditions de l’Atelier, 2015.
PERQUIN Jean-Louis Les Opérateurs radio clandestins, SOE, BCRA, OSS, Paris, Histoire et Collections, 2011.
SANSICO Virginie La Justice déshonorée, 1940-1944, Paris, Tallandier, 2015.
THIERY Laurent «L’ange gardien des V1 face à la Résistance» in La répression allemande dans le Nord de la France (1940-1944), Lille, Septentrion, 2013, p. 239-256.
SITOGRAPHIE ET MULTIMEDIAS
DÄNZER-KANTOF BORIS Les avocats agréés auprès des tribunaux militaires allemands in La Résistance en Île-de-France, CD-ROM. Paris - AERI, 2004.
DÄNZER-KANTOF BORIS Notices biographiques individuelles des 7 résistants du Procès de la Chambre des députés, in La Résistance en Île-de-France, CD-ROM. Paris - AERI, 2004.
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : WWW.DEFENSE.GOUV.FR
Publie sur son site le Bulletin officiel des Armées, dont l’édition méthodique (BOEM) présente l’architecture des grandes familles de résistance et les dispositions applicables à leurs membres ou agents. On s’y reportera avec intérêt, notamment pour toute question relative au statut des FFL, FFC, RIF, DIR, CVR, réfractaires au STO et passeurs bénévoles.
Le texte intégral du décret 366 du 25 juillet 1942 et celui de sa circulaire d’application sont consultables sur : www.bo.sga.defense.gouv.fr/boreale_internet (accès BOEM/le personnel/dispositions générales/combattants de la Résistance)
WWW.CHEMINSDEMEMOIRE.GOUV.FR Retrouvez votre revue en ligne.
WWW.LACOUPOLE-FRANCE.COM Site Internet lié aux armes "V".
WWW.SERVICEHISTORIQUE.SGA.DEFENSE.GOUV.FR Le site du SHD.
WWW.FMD.ASSO.FR Fondation pour la mémoire de la Déportation.
WWW.FONDATIONSHOAH.ORG Fondation pour la mémoire de la Shoah.
WWW.FONDATIONRESISTANCE.ORG Fondation de la Résistance. Retrouvez notamment Les réseaux Action de la France combattante (édition 1986 et 2008 pour la version électronique) et les chapitres téléchargeables sur le site de la Fondation.
WWW.FRANCE-LIBRE.NET Fondation de la France libre.
WWW.MONT-VALERIEN.FR Le Mont-Valérien - Haut lieu de la mémoire nationale.